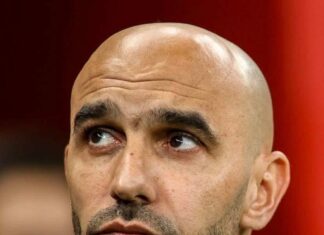L’instauration du système de parrainage des candidatures à l’élection présidentielle au Bénin, introduit par les réformes politiques récentes, visait officiellement à rationaliser le paysage électoral et à consolider la gouvernance démocratique. Ce mécanisme, inspiré de modèles étrangers, devait permettre de filtrer les candidatures jugées non sérieuses, afin d’éviter la dispersion des voix et de garantir la stabilité institutionnelle.
Cependant, une analyse approfondie de son application montre que le dispositif, loin de renforcer la démocratie représentative, a eu pour effet pervers de confisquer l’expression du choix populaire au profit d’une minorité d’élus. Ce système constitue, dans les faits, une délégation arbitraire du pouvoir électoral, opérant une rupture entre la volonté du peuple souverain et la sélection des candidats à la magistrature suprême.
- Le parrainage: un transfert de souveraineté du peuple vers ses elues
Le principe démocratique repose sur l’idée que la légitimité du pouvoir émane du peuple, dont le vote constitue l’expression directe de la souveraineté. Or, le système de parrainage, tel qu’implémenté au Bénin, introduit un intermédiaire obligatoire entre le peuple et les prétendants à la présidence.
Désormais, un citoyen désireux de se présenter à l’élection présidentielle ne peut le faire qu’à condition d’obtenir un certain nombre de parrainages émanant de députés ou de maires. Ces élus, investis d’un mandat représentatif, se voient ainsi conférer un pouvoir discrétionnaire de sélection, qui dépasse largement la portée de leur mission initiale.
Ce mécanisme revient, en réalité, à déplacer le centre de décision électorale : l’initiative populaire est remplacée par une initiative d’élite. Le peuple, censé être à la base du processus démocratique, se retrouve dépossédé de sa capacité d’influencer la configuration de l’offre politique.
- Une distorsion du mandat représentatif et une personnalisation du pouvoir de parrainage.
Dans une démocratie représentative, l’élu est le dépositaire d’un mandat général: il agit au nom de la collectivité et non selon ses intérêts particuliers. Cependant, le système de parrainage béninois ouvre la voie à une personnalisation de ce mandat.
En effet, rien n’oblige un député ou un maire à accorder son parrainage selon des critères transparents ou objectifs. Ce dernier peut être octroyé en fonction d’allégeances partisanes, d’intérêts personnels ou d’opportunités politiques. Le parrainage devient ainsi un instrument de stratégie individuelle ou de fidélité partisane, et non un acte de représentation démocratique.
Cette dérive engendre une double distorsion : d’une part, les élus ne reflètent plus la diversité des aspirations de leurs électeurs; d’autre part, la compétition politique se trouve verrouillée au profit de groupes installés au sommet de la hiérarchie politique. Autrement dit, la loi, en prétendant rationaliser, institutionnalise la sélection oligarchique.
III. Un recul démocratique sous couvert de rationalisme politique
L’un des arguments avancés pour justifier le parrainage est la nécessité de limiter le nombre de candidatures jugées non sérieuses. Si cette logique de rationalisation peut paraître légitime, elle ne saurait se faire au détriment du principe fondateur du pluralisme qui constitue l’un des piliers de la démocratie.
Dans le cas béninois, le dispositif actuel s’apparente à une r est r i ct ion du cha m p él e ct 0 rai, où seuls les candidats adoubés par les élites politiques peuvent concourir. Cette situation exclut de facto les indépendants, les représentants de la société civile et les formations émergentes, privant ainsi les électeurs d’une réelle diversité de choix.
La conséquence est claire : le citoyen est relégué au second plan du processus électoral, ne pouvant voter que parmi des candidats déjà triés et validés par un cercle restreint d’élus. Le suffrage universel devient alors un simple rituel de légitimation, et non l’expression authentique d’une souveraineté populaire.
- Les implications politiques et symboliques du dispositif
Au-delà de ses effets pratiques, le parrainage comporte des implications symboliques majeures. Il modifie la perception de la démocratie béninoise, autrefois saluée comme un modèle de pluralisme et de participation citoyenne en Afrique de l’Ouest.
L’esprit de la Conférence nationale de 1990 reposait sur l’idée que chaque citoyen devait pouvoir contribuer à la construction du destin collectif, notamment par la liberté de candidature et le choix plural des représentants. En remplaçant ce principe par un filtrage exercé par des élus déjà en place, le Bénin s’éloigne de son héritage démocratique pour s’orienter vers une démocratie de délégation, où la participation du peuple est formelle plutôt que réelle.
Le parrainage, tel qu’il est appliqué, participe donc à un mouvement plus large de recentralisation du pouvoir, où les élites politiques monopolisent la définition du champ démocratique.
Conclusion
Le système de parrainage, dans sa configuration actuelle au Bénin, constitue un détournement du principe de souveraineté populaire. En confiant à un groupe restreint d’élus le pouvoir exclusif d’autoriser ou non les candidatures présidentielles, la loi prive les électeurs à la base de leur droit fondamental à choisir librement leurs dirigeants.
Loin d’être un simple instrument technique, ce dispositif redéfinit la nature même du rapport entre gouvernants et gouvernés. Il substitue à la logique du suffrage universel une logique de cooptation, où le politique prime sur le démocratique.
Pour restaurer la vitalité démocratique béninoise, une réforme du système de parrainage s’impose – non pas pour le supprimer nécessairement, mais pour le ré ancrer dans la volonté populaire. C’est à cette condition seulement que le Bénin pourra renouer avec l’esprit fondateur de sa démocratie: le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le pleuple.
Vital Panou