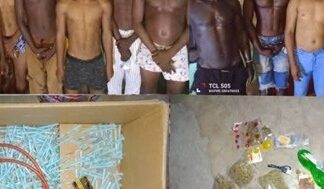Le panégyrique clanique est un patrimoine qui s’inscrit dans le registre de l’oralité. Il s’agit d’un éloge public. Au sens strict, c’est un discours à la louange d’un personnage illustre. Très répandu en Afrique, continent de l’oralité, ce patrimoine aujourd’hui perd du terrain au Bénin. Et qu’est ce qui explique ce phénome ? Un tour dans les régions de Grand Popo et d’Agoué nous affiche le constat effarant.
Une virée rapide, les 16 et 17 mai 2025 avec une équipe de recherche de thèse, dans quelques établissements scolaires de la commune de Grand Popo au contact des apprenants pour en savoir un peu plus sur la connaissance qu’ils ont encore du Panégyrique clanique et l’on tombe à la renverse. En dehors de quelques-uns, de nombreux apprenants rencontrés sur place qui arrivent à déclamer un bout de leur panégyrique, la grande masse restante étonne par leur inculturation qui saute à l’œil. Généralement transmis de bouche à oreille par les parents, et ceci de génération en génération, le panégyrique clanique n’est plus forcément aujourd’hui ce qui fait l’appât de la jeunesse. Peut être qu’il est remplacé par l’invasion des appareils de la nouvelle technologie. Mais tout compte fait, le constat est étonnant. La transmission n’est plus faite comme au temps jadis. Germain C. est un élève de 11 ans en classe de sixième au CEG Avlô, un village situé dans la commune de Grand Popo. Pour lui, il n’est pas important de maîtriser un quelconque panégyrique pour le simple fait qu’il a une posture religieuse qui ne le lui permet pas. « Moi je ne connais pas ce qu’on appelle Panégyrique » va-t-il déclarer sur la question de la définition du mot d’abord. Mais à la suite de moulte explications aussi bien en français que dans les langues locales, lorsqu’il a finalement compris de quoi il était question voici ce qu’affirme le jeune Germain. « Moi j’entends par moment ces choses là mais je ne suis souvent pas intéressé ». Et sur la question pourquoi ne l’est-il pas souvent, Germain fait savoir que lui, il est pentecôtiste et que « son église n’admet pas ces choses ». Une chosification systématique qui dresse le tableau noir de la représentation de ce patrimoine dans l’esprit du jeune homme. Premier point d’achoppement qui touche sensiblement ce patrimoine et qui le condamne à perdre totalement du terrain. Et tout comme Germain, beaucoup d’autre jeunes de son établissement adoptent cette même posture. Par ailleurs, il y en a d’autres qui eux, n’en savent pas grande chose, pas parce qu’ils appartiennent à une religion importée ou révélée qui leur aurait interdit cela sous prétexte que c’est diabolique, mais plutôt parce que depuis leur naissance ils n’ont jamais eu un parent qui ait fredonné un bout de texte de ce genre à côté d’eux. Nicolas D., élève en classe de quatrième au CEG d’Ayi-Guinnou (commune de Grand Popo) répond juste par un sourire expressif de sa vacuité lorsqu’on lui a demandé de dire son panégyrique. Tout sur son visage affiche clairement qu’il n’a jamais été au contact d’un tel patrimoine bien qu’il soit issu d’une famille ancrée dans la tradition. Vu que les parents eux même n’en ont pas connaissance ou ne l’ont jamais évoqué à ses côtés. Ce qu’il a fini par avouer après son long sourire soucieux. Quant à Hélène A. élève de 18ans en classe de troisième au CEG Avlô appartenant à l’ethnie Xwla, elle maîtrise un bout de son panégyrique dénommé ‘’Gbadou’’. Elle affirme l’avoir appris de sa grande mère et cela remonte vers ses six ans. Sur la question quel est l’intérêt qu’elle y trouve ? Hélène affirme que pour elle son panégyrique représente pour elle une véritable source d’affirmation de son identité et qu’elle en est fière. « Lorsqu’on me chante mon panégyrique, je me sens fière et joyeuse. Cela m’apaise et me procure une forte sensation d’élévation et de courage » va-t-elle mentionner en invitant le reste de ses camarades à aller à cette connaissance qui n’a rien de diabolique, mais qui, bien au contraire, favorise l’affirmation de soi au travers des hauts faits accomplis par les ancêtres tutélaires. Et parallélisme pour parallélisme, « Béhanzin représente pour le béninois, ancien dahoméen ce que Jésus représente pour les juifs » soulignera en filigrane dans les propos les sages et gardiens de temples rencontrés dans le temple de la divinité Lankpan à Agoué Adjigo dans le cadre de la même recherche. Une manière de mettre un point d’honneur sur le fait qu’il serait plus intéressant de célébrer les ancêtres africains et d’en être fier que de se préoccuper à louanger à longueur de temps celui qui a été imposé par des coups de fouets.
Teddy GANDIGBE