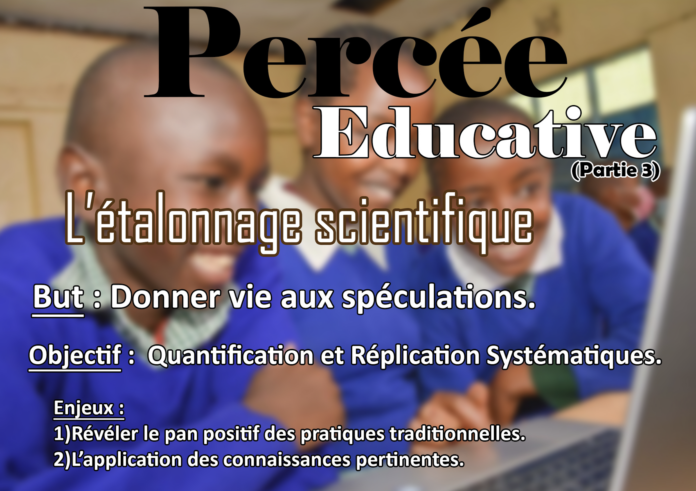Dans le village de Sèna, en Afrique de l’Ouest, une querelle entre deux clans sur une terre fertile menaçait de dégénérer en violence. Taagbo Dokounnon, un marabout respecté, invoqua son totem d’abeilles, symbole de justice et d’équilibre. Lors du rassemblement des clans, un essaim d’abeilles encercla la foule, forçant les participants à fuir. Étrangement, aucune abeille ne piqua : elles imposaient seulement leur présence comme un avertissement. Cet événement, interprété comme un appel à la paix, permit à Taagbo de réconcilier les clans, qui partagèrent la terre équitablement. Depuis ce jour, à Sèna, les abeilles sont vénérées comme gardiennes spirituelles, symbolisant l’harmonie entre les hommes et la nature.
Les initiés africains, bien que dotés de capacités extraordinaires, souffrent d’un manque de reconnaissance et de valorisation en raison de l’absence de documentation et d’étalonnage scientifique. Leurs exploits, allant de la manipulation des éléments naturels comme la pluie et la foudre à des pratiques occultes complexes, restent inexploités pour le développement culturel et économique. Ces capacités incluent la surveillance à distance, la création de maladies, et des interventions astrales, souvent utilisées pour résoudre des conflits ou aider des malades. Cependant, ces pratiques, bien qu’impressionnantes, suscitent des incidents inexpliqués et des controverses, notamment lorsqu’elles interfèrent avec des événements sociaux ou causent des dommages imprévus.
Malgré ces défis, les Africains cherchent à concilier leurs traditions avec des influences modernes pour affirmer leur identité et résoudre leurs problèmes. Les initiés utilisent leurs pouvoirs pour des actions hostiles ou bienveillantes, souvent dans des cadres secrets comme des couvents ou des lieux sacrés. Parallèlement, la société africaine explore des méthodes alternatives de paix intérieure et de rédemption, notamment à travers la prolifération des religions. Conscients de leurs richesses humaines et naturelles, les Africains s’efforcent de développer des solutions endogènes pour surmonter les obstacles et promouvoir un avenir durable.
En associant l’anecdote des abeilles à la technologie moderne comme les drones est une métaphore puissante pour souligner l’importance de quantifier et valoriser les pratiques traditionnelles. Développons cette idée en identifiant chaque phase de la mise en œuvre d’un tel concept, à la fois mystique et technologique :
Les phases de mise en œuvre : Du déferlement des abeilles aux drones
- Identification de l’objectif stratégique
- Définir clairement l’intention : résoudre un conflit, protéger une zone, ou imposer une décision.
- Dans l’anecdote, l’objectif était d’arrêter une querelle et de rétablir la paix. Avec un drone, ce pourrait être de surveiller un territoire ou dissuader une intrusion.
- Analyse des capacités locales
- Inventaire des ressources disponibles : abeilles (dans l’anecdote), ou dispositifs technologiques (comme des drones dans le contexte moderne).
- Identifier les forces traditionnelles (les essaims d’abeilles gérés par Taagbo Tokounou) et les combiner avec les outils modernes pour une meilleure efficacité.
- Conception et préparation
- Dans l’anecdote :
oLe marabout entretenait et entraînait ses abeilles, représentant la sagesse et une planification invisible mais efficace.
- Avec les drones :
oConcevoir des drones équipés pour des missions spécifiques : caméras, haut-parleurs, ou dispositifs non létaux.
oTraduire l’instinct des abeilles (organisation, coordination) en algorithmes de vol autonome ou synchronisé.
- Activation (Le lancement)
- Pour les abeilles : Invocation par des incantations ou des vibrations spécifiques, agissant comme un déclencheur.
- Pour les drones : Activer le système via des commandes programmées ou des interventions en temps réel, selon les besoins.
5.Phase d’exécution (L’intervention)
- L’attaque ciblée :
oLes abeilles : Encercler la foule sans nuire, en montrant une présence autoritaire.
oLes drones : Imposer une présence visuelle ou sonore (via haut-parleurs, par exemple) pour provoquer une dispersion ou rappeler une règle.
- Gestion du retour au calme
- Les abeilles : Rappelées par l’apaisement du marabout, elles retournent à leur ruche.
- Les drones : Retour à leur base après avoir accompli leur mission, avec une collecte des données pour analyse.
7.Apprentissage et amélioration
- Documenter les observations :
oPour Taagbo Dokounou : Adapter ses pratiques mystiques en fonction des situations futures.
oPour les drones : Analyse des données pour optimiser les interventions futures.
Vers l’étalonnage scientifique : Quantifier les pratiques traditionnelles
Cette vision pourrait inclure la mise en place de laboratoires pour étudier ces approches, former des experts sur le terrain, et produire des solutions « hybrides » entre tradition et modernité. Ainsi, en s’appuyant sur cette anecdote, l’idée maîtresse de cette partie l’étalonnage scientifique pourrait être la suivante :
- Transformer les pratiques ancestrales : Identifier, analyser, et codifier des phénomènes mystiques comme celui des abeilles pour les intégrer dans des systèmes modernes (comme des drones).
- Créer un arsenal moderne : Mettre en synergie l’ingéniosité locale et les avancées technologiques pour proposer des solutions adaptées aux contextes africains.
- Revaloriser l’identité locale : Prouver que l’innovation peut puiser dans les racines traditionnelles pour résoudre les défis contemporains.
Pour concrétiser cette vision ambitieuse et essentielle, la feuille de route stratégique en plusieurs étapes ci-après peut aider à mettre en place des laboratoires et construire un écosystème solide qui fusionne tradition et modernité :
- Diagnostic initial et étude de faisabilité
- Cartographier les pratiques traditionnelles : Identifier et documenter les pratiques ancestrales pertinentes (comme l’utilisation des abeilles ou d’autres techniques naturelles).
- Évaluer les besoins : Déterminer les domaines prioritaires (défense, santé, agriculture, énergie, etc.) où ces pratiques peuvent être hybridées avec des technologies modernes.
- Engager des experts locaux et/ou internationaux : Associer des praticiens traditionnels, des chercheurs et des ingénieurs pour une collaboration interdisciplinaire.
- Mise en place des laboratoires
- Infrastructures adaptées :
oCréer des laboratoires multidimensionnels équipés pour des études biologiques, technologiques et mécaniques.
oAssurer des ateliers pratiques pour reproduire et étudier les phénomènes comme l’organisation des abeilles ou d’autres systèmes naturels.
- Centre de recherche et d’expérimentation :
oConcevoir un centre dédié à la recherche appliquée, à l’expérimentation et au prototypage technologique.
- Formation des experts et équipes locales
- Développer des programmes de formation :
oEnseigner la quantification et la codification des pratiques traditionnelles.
oFormer des ingénieurs et techniciens en collaboration avec les acteurs traditionnels.
- Créer une synergie entre tradition et technologie :
oFaciliter l’échange de savoirs entre les praticiens traditionnels et les scientifiques modernes.
- Recherche, développement et innovation
- Projets pilotes :
oTester l’intégration des pratiques traditionnelles et des technologies modernes (comme la gestion des abeilles avec des drones pour la sécurité).
- Concevoir des solutions hybrides :
oPar exemple, développer des drones « bio-inspirés » qui imitent le comportement des essaims d’abeilles pour des missions précises.
- Valorisation et impact
- Produire des solutions concrètes :
oDéployer des outils technologiques basés sur ces recherches pour des applications dans la défense, l’agriculture ou la sécurité publique.
- Sensibilisation :
oPromouvoir ces innovations pour souligner la richesse des savoirs africains et leur rôle dans la modernité.
- Création d’une institution de recherche africaine
- Établir une institution continentale dédiée à la recherche hybride entre pratiques traditionnelles et technologie moderne.
- Assurer que le Bénin soit un pionnier dans ce domaine en établissant un exemple à suivre.
Cette initiative sera un pas décisif vers la souveraineté technologique et culturelle, démontrant que les solutions du futur peuvent s’appuyer sur les racines du passé. En avançant avec une planification stratégique et un engagement à long terme, cette vision peut transformer le Bénin en un modèle de créativité et de puissance technologique « africainement africaine ».
Répertorier, quantifier, orienter et développer encapsule parfaitement l’approche stratégique nécessaire pour transformer les pratiques traditionnelles en solutions modernes et hybrides. Cette démarche méthodique montre bien notre vision et notre engagement à faire du Bénin un pionnier dans la création d’un arsenal « africainement africain ». Cela donne une méthodologie claire et opérationnelle pour structurer le processus.
Voici comment ces étapes peuvent être organisées dans ce programme :
1.Répertorier : Identifier les savoirs, pratiques et ressources traditionnelles pertinentes, en mettant en lumière leurs impacts et leurs potentiels (comme les techniques ancestrales autour des abeilles).
2.Quantifier : Mesurer et codifier ces pratiques pour évaluer leur efficacité, leur portée et leur compatibilité avec les technologies modernes. Cela inclut des études approfondies et des analyses concrètes.
3.Orienter : Définir des objectifs stratégiques en fonction des résultats, et guider les recherches vers des applications spécifiques comme la défense, l’industrie ou l’agriculture.
4.Développer : Transformer les connaissances quantifiées en produits et solutions pratiques, comme des drones bio-inspirés ou des systèmes de sécurité innovants.
La quantification reste l’étape essentielle de cette vision qui met en avant une approche systématique où la logique derrière chaque étape est déterminante. Trouver cette « formule » ou cette séquence reproductible est essentiel pour garantir que les résultats soient cohérents et applicables, peu importe le contexte. Cette approche de quantification reflète bien l’essence scientifique et analytique de l’étalonnage scientifique, tout en puisant dans les racines des pratiques africaines. C’est exactement cette clarté dans la méthode qui peut transformer les savoirs ancestraux en systèmes modernes, fonctionnels et impactants. En d’autres termes, il s’agit :
1.D’identifier les composantes (A et B) : Comprendre les éléments de départ, qu’ils soient naturels, culturels, humains ou technologiques.
2.D’établir les interactions (La logique) : Étudier comment ces composantes interagissent pour produire un résultat, en déterminant les variables et conditions.
3.De valider le résultat (Z) : Tester pour s’assurer que cette logique est reproductible et donne les mêmes résultats à chaque application.
Comment relier ces notions à ton idée ?
- La logique de progression : À chaque étape (par exemple, de la mobylette à la moto), il y a eu une observation, une amélioration et une application rigoureuse. Cette logique correspond à « Répertorier, Quantifier, Orienter, Développer ».
- Les solutions africaines : Montrer que comme les télécommandes ou les avions, nos pratiques traditionnelles peuvent être modernisées pour devenir des outils puissants.
- Les laboratoires africains : Par exemple, imaginer un « drone inspiré des abeilles » ou un « système de réunion numérique pensé pour les zones rurales », accessible et adapté à nos réalités.
Il existe plusieurs anecdotes de cris de coeur des Africains tel que: Quand la grand-père regarde dans un vase et voit son fils à l’étranger, nous l’appelons la sorcellerie. Mais si l’Européen prend ton Android et parle avec quelqu’un à des milliers de km, nous l’appelons sorcellerie occidentale ou technologie. Cette comparaison révèle la frontière souvent floue entre perception et compréhension dans différents contextes. Voici une réflexion que l’on pourrait tirer de ces anecdotes : Ce que l’on qualifie de « sorcellerie » ou de « technologie » dépend en grande partie de notre connaissance et de notre cadre culturel. Quand une innovation dépasse notre compréhension immédiate, elle peut sembler magique ou mystique. Ce n’est que lorsque nous explorons et décryptons ses mécanismes que nous la repositionnons dans le domaine de la science ou de la technologie.
Un Africain qui regarde dans un vase et voit son fils à l’étranger pourrait utiliser une technique traditionnelle, encore inexpliquée par les méthodologies scientifiques modernes. De même, l’Européen qui parle sur son téléphone utilise simplement une technologie dont les fondements ont été étudiés, codifiés et industrialisés.
Alors, que dire, que faire ?
- Il faut apprendre à valoriser les savoirs africains, les étudier et les codifier pour qu’ils soient reconnus comme de véritables contributions au progrès humain.
- La « sorcellerie » ou les pratiques ancestrales ne sont pas opposées à la technologie ; elles peuvent être vues comme les prémices ou une autre forme d’innovation qui attend encore d’être pleinement expliquée par des approches scientifiques.
- Ce qui différencie la « technologie » d’une « pratique mystique », c’est la quantification et la réplication systématique. Si nous pouvons faire pour nos pratiques ancestrales ce que d’autres ont fait pour leurs découvertes scientifiques, nous leur donnerons une place dans le monde moderne.
En Afrique, la tendance est de voir le côté négatif de tout alors que nous vivons dans un monde de dualité où le positif et le négatif sont les deux faces de la même pièce. Alors comment gérer cette tendance généralisée malheureusement?
Le défi de reconnaître la dualité entre le positif et le négatif tout en cultivant une vision équilibrée. Pour contrer cette tendance généralisée à se focaliser sur le négatif, voici quelques pistes à envisager :
- Changer le cadre mental : la psychologie du progrès
- Valoriser les succès : Promouvoir les exemples positifs issus d’initiatives locales et régionales pour montrer que des progrès concrets sont possibles. L’inspiration est contagieuse !
- Éducation à la pensée critique : Apprendre à analyser les situations sous différents angles, à comprendre que chaque événement comporte des défis (le négatif) et des opportunités (le positif).
- Redéfinir les échecs : Considérer les échecs comme des leçons ou des étapes pour parvenir à des succès. La formule serait : « Ce n’est pas un obstacle, c’est une marche d’escalier. »
- Renforcer les récits collectifs positifs
- Mettre en avant l’histoire africaine sous son meilleur jour : Au-delà des périodes sombres, rappeler les grandes réalisations des civilisations africaines pour bâtir une fierté et une confiance collective.
- Multiplier les héros locaux : Donner une visibilité accrue à ceux qui innovent, inspirent et transforment positivement leurs communautés.
- Médias optimistes : Encourager la diffusion d’histoires positives dans les médias africains pour nourrir une dynamique de progrès.
- S’entourer de leaders et d’initiatives optimistes
- Leadership inspirant : Identifier et soutenir des dirigeants qui incarnent une vision constructive et inclusive.
- Initiatives communautaires : Appuyer des projets où les solutions sont co-créées par les communautés elles-mêmes, valorisant ainsi leur potentiel.
- Encourager une culture du dialogue et du débat constructif
- Créer des espaces sûrs pour parler : Où chacun peut s’exprimer sans jugement, favorisant l’émergence d’idées équilibrées.
- Recadrer les critiques : Transformons les plaintes en propositions : « Que proposons-nous pour améliorer cela ? »
- Pratiques individuelles pour nourrir le positif
- La gratitude quotidienne : Encourager les gens à remarquer, chaque jour, au moins trois choses positives autour d’eux.
- Les petits gestes d’impact : Montrer que contribuer positivement à sa communauté, même à petite échelle, peut créer un changement global.
En Afrique, comme ailleurs, le monde fonctionne dans une dynamique où le positif et le négatif coexistent. L’objectif n’est pas d’ignorer les défis, mais d’apprendre à les transformer en opportunités. Cultiver cet équilibre peut galvaniser un continent à reconnaître la richesse de ses ressources humaines, culturelles et intellectuelles.
Ensemble, les Africains peuvent apprendre à célébrer leurs réussites tout en affrontant leurs difficultés avec créativité et résilience.
Pour développer un arsenal de guerre propre aux Africains, basé sur une synergie entre pratiques traditionnelles et technologies modernes, voici une approche structurée et adaptée à nos réalités :
- Répertorier les savoirs et ressources locales
- Identifier les pratiques ancestrales pertinentes, comme l’utilisation des abeilles, des plantes médicinales ou des techniques de défense traditionnelles.
- Cartographier les ressources naturelles et humaines disponibles, en mettant en avant les savoirs des anciens et des communautés locales.
- Quantifier et analyser
- Étudier scientifiquement ces pratiques pour comprendre leur logique et leur efficacité. Par exemple, analyser comment un essaim d’abeilles peut être dirigé ou comment certaines plantes peuvent être utilisées pour des applications stratégiques.
- Développer des modèles reproductibles : établir des protocoles clairs pour que ces pratiques puissent être appliquées de manière cohérente.
- Intégrer la technologie moderne
- Inspirations bio-technologiques : Créer des drones ou des dispositifs inspirés des comportements naturels (comme les abeilles ou les oiseaux migrateurs).
- Technologies adaptées : Développer des outils simples mais efficaces, comme des capteurs, des systèmes de communication sans fil ou des mécanismes de défense basés sur des innovations locales.
- Former et autonomiser
- Mettre en place des centres de formation pour transmettre ces savoirs hybrides aux jeunes générations.
- Former des experts capables de combiner tradition et modernité, en leur donnant les outils pour innover.
- Prototyper et tester
- Lancer des projets pilotes pour tester ces solutions dans des contextes réels.
- Ajuster et améliorer les prototypes en fonction des résultats Breveter les innovations issues de cette démarche pour garantir qu’elles restent une propriété africaine.
- Promouvoir ces solutions comme des exemples de souveraineté technologique et culturelle.
- Créer une dynamique panafricaine
- Collaborer avec d’autres pays africains pour partager les savoirs et développer des solutions communes.
- Mettre en place une institution panafricaine dédiée à la recherche et au développement d’arsenaux stratégiques basés sur les réalités africaines.
Qu’il vous souvienne, le 29 mai 2020, j’avais publié : « Nos sciences traditionnelles sont des moteurs pour nos savoirs économiques ». En vérité, les sciences traditionnelles ne sont pas juste des reliques du passé, mais des ressources dynamiques capables de transformer les économies locales et nationales si elles sont étudiées, adaptées et intégrées aux systèmes modernes. C’est en mêlant tradition et modernité que nous pourrons propulser notre nation vers des horizons nouveaux, où chaque initiative contribuera à enrichir notre patrimoine commun.
Enfin, je nous invite donc à unir nos forces pour écrire une nouvelle page de l’histoire du Bénin. Car c’est par nos efforts conjoints que nous pouvons bâtir une nation fière, rayonnante et tournée vers l’avenir. Ce travail ne peut se faire sans vous : jeunes talents, entrepreneurs, chercheurs et leaders visionnaires en étroite symbiose avec la chefferie traditionnelle.
Ensemble, construisons cette vision !
Ensemble transformons le Bénin en une terre d’innovation, de progrès et de prospérité !
Ensemble, écrivons une nouvelle page de l’histoire de notre nation !