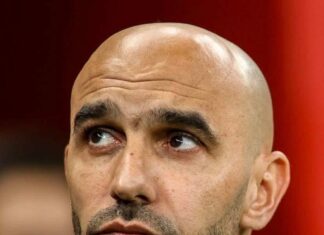Ministre-conseiller auprès du président de la République en charge de la santé, Claudine Afiavi Prudencio fait une étude académique de la réforme constitutionnelle opérée le 15 novembre 2025. De l’utilité d’un Sénat, d’une trêve politique à l’alignement sur 7 ans de tous les mandats électifs, elle fait une analyse qui fait sortir les ressorts de cette révision, la rationalité, les limites éventuelles et les perspectives.

PRÉAMBULE
La Constitution est l’espace où une nation traduit, dans un langage juridique, ses rêves, ses peurs, ses ambitions et les leçons tirées de son histoire. Elle n’est jamais un texte figé : elle évolue, se retend, s’assouplit, se renforce ou s’amende lorsque les réalités de l’époque l’exigent.
La révision constitutionnelle opérée le 15 novembre 2025 au Bénin s’inscrit dans cette dynamique profonde. Elle ne relève ni de la contingence ni du réflexe politique. Elle procède d’une réflexion mûrie, attentive aux défis contemporains, soucieuse de consolider l’architecture institutionnelle et de préserver les équilibres nécessaires au développement harmonieux du pays.
Cette étude se propose d’examiner cette réforme sous un angle strictement académique : comprendre l’esprit de la révision, analyser les outils qu’elle mobilise, interroger ses innovations, décortiquer ses critiques, et situer sa portée historique au sein des démocraties africaines francophones contemporaines.
L’approche retenue est résolument pluridisciplinaire:
- juridique, pour l’analyse des normes ;
- politique, pour l’étude des rapports de force ;
- philosophique, pour éclairer les principes ;
- sociologique, pour la prise en compte des réalités sociales ;
- anthropologique, pour intégrer les logiques culturelles propres au pays.
L’objectif n’est pas de célébrer ni de dénoncer, mais de comprendre, de manière exigeante, distanciée et rigoureuse.
INTRODUCTION GÉNÉRALE
Depuis la Conférence nationale de février 1990, souvent décrite comme l’instant fondateur de la démocratie béninoise moderne, la question de la révision constitutionnelle a toujours été entourée d’une forme de sacralité. La Constitution de 1990 a servi de boussole, de rempart et d’horizon à une nation qui retrouvait sa voix et redéfinissait son avenir après des décennies de turbulences politiques.
Mais une Constitution, si robuste soit-elle, n’est pas une relique. Elle doit pouvoir s’adapter aux réalités nouvelles, aux mutations économiques, aux tensions politiques, aux attentes sociales, et aux défis de gouvernance d’un monde qui change rapidement.
La réforme de 2025 intervient à un moment où le Bénin fait face à plusieurs enjeux majeurs :
- comment renforcer la stabilité institutionnelle dans un environnement politique parfois polarisé ?
- comment accorder davantage d’espace à la sagesse, à la mémoire, et à l’expérience de ceux qui ont porté haut l’État béninois ?
- comment structurer le temps politique pour permettre l’efficacité publique sans sacrifier la reddition des comptes ?
- comment éviter la politisation toxique permanente qui fragilise l’action publique ?
- comment garantir l’éthique du mandat représentatif dans un contexte où la transhumance parlementaire a longtemps miné la confiance des électeurs?
Autant de questions auxquelles la révision apporte des réponses institutionnelles, articulées autour de quelques axes majeurs :
- la création d’un Sénat ;
- la reconfiguration du temps politique avec l’instauration d’un septennat ;
- la formalisation de la trêve politique ;
- l’encadrement strict de la transhumance parlementaire ;
- une procédure de révision transparente, conforme aux principes constitutionnels.
Chacune de ces dimensions sera étudiée en profondeur afin d’en saisir les ressorts, la rationalité, les limites éventuelles et les perspectives.
I – LES FONDEMENTS HISTORIQUES ET POLITIQUES DE LA RÉFORME
- Le legs de 1990 : une démocratie fondée sur l’équilibre et la prudence
La Conférence nationale a établi un socle politique fait de pluralisme partisan, d’indépendance judiciaire, de contrôle constitutionnel et de séparation rigoureuse des pouvoirs. Cependant, la Constitution de 1990, conçue dans un contexte post-crise, portait en elle une prudence extrême, parfois au détriment de l’efficacité institutionnelle.
Dès l’origine, un Sénat avait été envisagé comme chambre de tempérance, mais l’idée avait été écartée pour des raisons budgétaires et politiques. L’absence d’un organe de sagesse institutionnelle a laissé un vide que trois décennies de pratique politique ont révélé.
- L’évolution sociopolitique depuis 1990 : tensions, maturité et limites
Le système politique béninois a progressivement révélé certaines fragilités :
- une compétition politique souvent exacerbée ;
- des stratégies récurrentes de déstabilisation ;
- une difficulté à sanctuariser la stabilité nationale ;
- un rapport ambigu au temps politique qui limite l’ambition des politiques publiques.
La réforme de 2025 répond à ces limites.
- Un second souffle constitutionnel
La révision constitutionnelle n’est ni un retour en arrière ni une rupture brutale.
Elle représente un ajustement majeur : un repositionnement de l’État autour de valeurs cardinales telles que la stabilité, la sagesse, la responsabilité, tout en renforçant les mécanismes démocratiques existants.
II – LE SÉNAT : UNE INSTITUTION DE SAGESSE POUR LE TEMPS LONG
- Justification philosophique et socio-anthropologique
Dans la tradition béninoise, les anciens jouent un rôle éminent dans la résolution des conflits, la préservation de la paix, l’arbitrage des tensions communautaires et la transmission du sens moral.
Les sociétés africaines ont toujours confié les grandes décisions à des « gardiens du temps », dépositaires de la mémoire collective.
Le Sénat s’inspire explicitement de ce modèle : il est moins une chambre politique qu’une institution de prudence.
- Composition et statut : la neutralité comme règle d’or
Les membres du Sénat ne sont pas élus.
Cette absence d’élection n’est pas un déficit démocratique, mais un choix visant à garantir la neutralité absolue et l’indépendance vis-à-vis des partis politiques.
Le Sénat devient ainsi :
- un espace de recul ;
- un lieu de distanciation ;
- une chambre de raison.
- Attributions : la force de la régulation
Le Sénat intervient pour :
- protéger l’unité nationale ;
- veiller à l’éthique des acteurs politiques ;
- empêcher la diffusion de discours incendiaires ;
- examiner les lois sensibles (loi fondamentale, lois électorales, lois relatives aux partis politiques) ;
- activer un mécanisme de non-objection, qui peut bloquer une loi dangereuse.
Ce pouvoir n’est pas un veto : c’est un mécanisme de préservation du pays.
- Le Sénat comme pare-feu face aux passions politiques
Le Bénin, comme d’autres démocraties naissantes, a parfois été confronté à des épisodes d’instrumentalisation politique outrancière, où des acteurs cherchent à provoquer la déstabilisation nationale. Le Sénat vient corriger cette dérive structurelle.
- Comparaison internationale
La House of Lords au Royaume-Uni, le Sénat italien ancien modèle, certains Conseils de sages africains… le Bénin innove en combinant ces modèles avec son propre génie culturel.
III – LE SEPTENNAT : RECONFIGURER LE TEMPS POLITIQUE
- Le temps en politique: entre courte vue et responsabilité
Machiavel, Weber, Arendt, tous ont montré que le temps politique conditionne la qualité des politiques publiques.
Un mandat de Cinq ans est parfois trop court pour des projets d’infrastructures, de réformes de fond, ou de transformations sectorielles.
- Pourquoi sept ans ?
Le septennat :
- offre un cycle complet : conception, financement, réalisation ;
- réduit la tentation du court-termisme ;
- renforce la continuité de l’État ;
- libère l’action publique du calendrier électoral oppressant.
- Une réforme sans bénéfice pour l’actuel Président
C’est l’une des singularités majeures de cette révision.
Contrairement à de nombreuses révisions africaines, le Président en exercice ne s’en sert pas pour prolonger son pouvoir.
C’est un signe de détachement, rare sur le continent.
- Avantages structurels du septennat
- développement économique cohérent ;
- stabilité des politiques publiques ;
- maturation institutionnelle ;
- pacification des cycles électoraux.
- Analyse critique
Tout changement comporte des risques — dérive potentielle, lourdeur ou moindre redevabilité — mais les garde-fous constitutionnels, parlementaires et juridictionnels demeurent solides.
IV – LA TRÊVE POLITIQUE : UNE ARCHITECTURE DU DÉBAT CIVILISÉ
- Clarification des concepts
La trêve politique n’est pas un silence démocratique.
C’est la suspension de la guerre politique permanente.
- Une innovation africaine majeure
Dans de nombreux pays, l’opposition consiste à affaiblir le pouvoir en place pour prouver sa propre valeur.
La trêve met fin à cette logique destructrice.
- Impacts attendus
- diminution de la conflictualité verbale ;
- meilleure concentration sur l’action publique ;
- responsabilité partagée dans la construction nationale.
- Une innovation juridique qui s’inscrit dans les pratiques électorales existantes
Les périodes électorales restent les temps du débat contradictoire absolu.
La trêve organise, clarifie et structure cette alternance.
- Polémique et malentendus : étude critique
Certains ont confondu trêve et musellement.
Cette analyse est infondée sur le plan juridique.
La trêve n’interdit ni critique, ni contribution, ni proposition.
Elle élimine seulement la stratégie de sabotage politique.
V – LA FIN DE LA TRANSHUMANCE POLITIQUE : UNE RÉVOLUTION ÉTHIQUE
- Transhumance parlementaire : analyse historique
Phénomène répandu en Afrique, il a souvent affaibli la cohérence des mandats et sapé la confiance des électeurs.
- L’innovation constitutionnelle
« Tout député qui démissionne du parti ayant porté sa candidature perd son mandat ».
C’est un changement profond du droit parlementaire béninois.
- Effets attendus
- fidélité aux électeurs ;
- discipline interne ;
- cohérence institutionnelle ;
- renforcement de l’intégrité du vote.
- Analyse critique
Certains y verront une limitation de la liberté individuelle.
Mais la démocratie ne consiste pas à trahir les électeurs sans conséquence.
- Une nouveauté alignée sur les exigences de gouvernance moderne
Cette mesure renforce la crédibilité des partis et stabilise l’architecture politique.
VI – PROCÉDURE DE RÉVISION : TRANSPARENCE ET LÉGITIMITÉ
- Respect strict de la Constitution
La révision a reçu la majorité qualifiée exigée par la Constitution.
C’est un fait constitutionnel indiscutable.
- L’apport du vote trans-partisan
90 voix pour : un chiffre qui dépasse les clivages habituels.
- Analyse de la polémique sur l’opacité
Les critiques proviennent souvent d’un imaginaire politique plutôt que d’une observation factuelle.
La procédure a été transparente, publique, assumée.
- Une démocratie représentative assumée
Le Bénin a choisi le modèle parlementaire pour la révision, conformément à sa tradition institutionnelle.
VII – PRÉSENTER LA RÉFORME AU PEUPLE : LE DEVOIR PÉDAGOGIQUE
- Le rôle du Parlement
Le Parlement vote.
Le Gouvernement explique.
C’est la logique de la démocratie représentative.
- Pourquoi ne pas avoir consulté avant ?
Parce que la Constitution elle-même prévoit cette procédure.
Parce qu’un référendum aurait été instrumentalisé.
- Transparence, pédagogie et appropriation citoyenne
La démarche post-vote permet au peuple de comprendre avant promulgation.
C’est un geste de responsabilité démocratique.
Enfin, la révision constitutionnelle du 15 novembre 2025 représente une maturation démocratique, non une rupture.
Elle réintroduit la sagesse dans le système politique, reconfigure le temps politique, clarifie les règles du jeu partisan, stabilise les institutions et protège le pays contre les dérives qui ont miné tant d’États africains.
Ce n’est pas une réforme de pouvoir.
C’est une réforme de protection, de vision, de responsabilité.
Elle marque une étape décisive dans le long processus de construction démocratique du Bénin, qui continue à se distinguer comme l’une des nations les plus structurées et les plus sereines du continent.