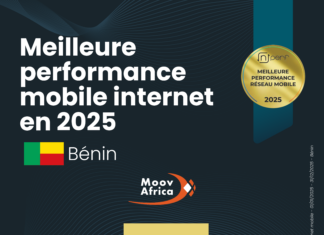Sur l’aventure »Dayihoun théâtre » dirigé par Ella Tchiakpè, et qui se déroule dans l’enceinte de la Bourse du travail à Cotonou, la compagnie »Africapsudtheâtre » a assuré, jeudi 23 janvier 2025, l’adaptation et la mise en scène du roman intitulé »Les fantôme du Brésil » dont l’auteur n’est rien d’autre que le prolifique écrivain béninois Florent Couao-Zotti.
C’est une histoire à la Roméo et Juliette transposée dans le contexte du Bénin et plus précisément à Ouidah. Un amour interdit qui s’éclate entre deux jeunes gens Pierre Kuassi Kpossou et Anna Maria Dolorès Do Santos, opposés par une histoire chargée de rancœur, vielle de plusieurs siècles, entre la communauté des béninois descendant d’esclaves venus de Brésil et les rejetons des autochtones esclavagistes vivant encore sur le territoire. Dans cette mise en scène assurée par Amah Codjovi Ebenezer, on lit tout bonnement que l’histoire est restée têtue et provoque perpétuellement le clivage dans une communauté a priori attachée par un lien de fraternité puissant. Pour les Agouda de Ouidah, symbolisé dans l’intrigue par la grande forêt Kpassè, il n’y a aucune excuse pour tolérer une quelconque relation amoureuse entre les enfants des anciens esclaves revenus de Brésil et les fils de ceux qui sont supposés être à la base du sombre commerce qui a conduit leurs ancêtres à une destinée condamnable, lugubre et irréversible. Et c’est à juste titre que le metteur en scène s’investit d’installer un tableau affichant une série de séquences teintées de violence, de pression, de hargne et de haine projetées par les do Santos à l’endroit de Pierre le fièrement amoureux et ses parents. « Oui, à celui qui a vendu nos pères aux blancs, il n’est pas question d’adresser un sourire de félicitations ». S’interdit la mère d’Anna Maria Dolorès dans le déroulé de la trame. Et c’est là tout le nœud de l’entêtement élastique de l’histoire qui oppose farouches les Agouda, qui se considèrent plus nobles depuis leur retour sur la terre mère, aux autochtones qui occupent la majeure partie des terres de la cité des Kpassè. C’est un spectacle chargé d’émotions qui fait réfléchir sur l’avenir d’un peuple assoiffé de progrès et d’union mais paradoxalement opposé par un conflit historique. Et cela laisse des questions en suspens à savoir : Si tant est que cette discorde continuera par faire perdurer le clivage et continuer toujours d’installer une atmosphère de haine et de mélancolie, pourquoi ces des descendants d’anciens esclaves, du moins la majeure partie qui reste encore dans les Caraïbes, au Brésil et autres endroits dans le monde réclament la nationalité et cherchent à retourner sur la terre mère ? Jusqu’à quand va durer cet entêtement de l’histoire qui défavorise l’union, le progrès et une nouvelle manière de voir le monde ? À quoi servira alors leur retour au bercail s’ils ne sont pas prêts à pardonner et à retisser de nouvelles cordes de paix, d’amour et de charité quand bien même on sait qu’il est difficile d’oublier une histoire douloureuse ? Puisque, à scruter de très près l’actualité et certains témoignages de sources concordantes, des nids résistants de ce type d’attitude existent encore jusqu’au à ce jour et ne sont pas prêts à être dissipés. « À quand l’Afrique ? » De Joseph Ki-Zerbo garde encore tout son sens dans ce contexte lorsque de nouveaux regards ne seront pas posés sur ce coin de l’histoire.
Teddy GANDIGBE